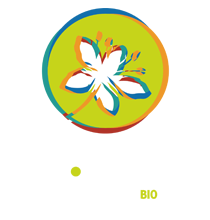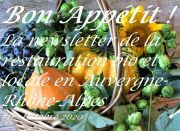Une newsletter trimestrielle sur l'actualité de la restauration bio et locale en Auvergne-Rhône-Alpes : le "Bon Appétit" !

ACTUS | Nouvelle édition de l'annuaire des fournisseurs bio de la région AuRA ( 2022-2024)
RECETTE | La recette bio et locale approuvée par un chef !
FOCUS | Retours d'expérience sur le dispositif "cantine à 1€" : Aide de l’État à la mise en place d'une tarification sociale des cantines scolaires
FORMATIONS | Accompagner le temps du repas en restauration scolaire, les équipes encadrantes se forment
RETOUR D'EXPERIENCE | La communauté de communes Ambert Livradois Forez accompagne ses restaurants collectifs !
TÉMOIGNAGE | « J'ai doublé mes achats en produits bio-locaux en 6 mois »
Pour le télécharger, cliquez ici.

FOCUS | Retours sur les réunions territoriales concernant la loi EGALIM et les outils d’accompagnement des acteurs de la RHD
INITIATIVE | Obligation incitative de remplir les données de suivi des approvisionnements sur le site Ma Cantine
AIDES | Dispositif « cantine à 1 € » : Aide de l’État à la mise en place d’une tarification sociale des cantines scolaires
| Dispositif « cantine à 1 € » : Aide de l’État à la mise en place d’une tarification sociale des cantines scolaires
INITIATIVE | Loire - élus, gestionnaires et cuisiniers en road-trip pour découvrir la restauration collective bio locale
FOCUS | Vidéos-témoignages "Mettre en place Egalim en resto co : ils l'ont fait !"
INITIATIVE | 40% de Bio pour plus de 2000 couverts jour, c'est possible !
INITIATIVE | Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais : accompagnement de communes dans le cadre de l’atteinte des critères de la loi EGALIM
SOUTIEN FINANCIER | 2 programmes pour financer une partie de l’approvisionnement bio et local de votre cantine !
Pour le télécharger, cliquez ici.
FOCUS | Série de webinaires régionaux : un franc succès
DOSSIER | Décryptage // Loi Climat et Résilience
INITIATIVE | Défi Collège à Alimentation Positive, allier accompagnement et pédagogie en Métropole Lyonnaise
INITIATIVE | Accompagnement du Pays grenoblois dans le cadre de son PAIT
ZOOM | Vos achats en restauration collective, une étude d'ampleur est lancée !
FOCUS | 3 webinaires pour s’informer et échanger
DOSSIER | Manger bio et local en entreprise, les restaurants INRAE du Puy-de-Dôme s'engagent !
INITIATIVE | Le restaurant intercommunal de Piégros la Clastre, un exemple à suivre !
TERRITOIRE | Venez découvrir la régie agricole de Mouans Sartoux (06) les 23 et 24 novembre
ZOOM | Vos achats en restauration collective, une étude d'ampleur est lancée !
Pour le télécharger, cliquez ici.
FOCUS | Les régies agricoles : une solution pour l'approvisionnement de sa restauration collective
DOSSIER | Structuration de filières maraîchage et légumineuse biologiques pour répondre aux objectifs en restauration collective
INITIATIVE | Enquête nationale sur la restauration collective
TERRITOIRE | Des réunions territoriales sur la loi EGAlim en Auvergne-Rhône-Alpes
ZOOM | Des légumeries altiligériennes pour approvisionner la restauration collective
FOCUS | «Un coup de fourchette pour le climat » : un séminaire FRAB AuRA
DOSSIER | L'observatoire de la restauration collective durable par Un Plus Bio
INITIATIVE | Plan de relance : aide aux cantines scolaires de petites communes
TERRITOIRE | Des réunions territoriales sur la loi EGAlim en Haute-Loire et en Ardèche
ZOOM | Un livret de Recettes pour les plats végétariens bio locaux et goûteux dans les collèges de la Drôme
FOCUS | Mangez bio et local c'est l'idéal, la campagne de valorisation de vos initiatives est de retour !
DOSSIER | COVID et restauration collective : les producteur.trices et plateformes se réorganisent
INITIATIVE | Un marché public revu pour collèges et lycées de Haute Loire
TERRITOIRE | PARCEL et TERRITOIRE BIO, des outils à destination des collectivités
ZOOM | Lu et vu ailleurs pendant le confinement
Pour le télécharger, cliquez ici.
FOCUS | Crise sanitaire COVID 19 et RHD
DOSSIER | Marsanne : une commune qui travaille sur ses marchés publics pour plus de bio !
INITIATIVE | Le projet "Alimentation : plaisir et sens pour les résidents en EHPAD" se poursuit en 2020
TERRITOIRE | PARCEL : un outil gratuit pour relocaliser l'alimentation de son restaurant collectif
ZOOM | Des pâtes bio et locales dans des restaurants collectifs
Pour le télécharger, cliquez ici.
FOCUS | Loi EGAlim, le réseau de la FRAB AuRA vous accompagne !
DOSSIER | Formations des collèges et restaurants scolaires en Drôme et Rhône/Loire
INITIATIVE | Les Armées répondent « présent » à la loi EGAlim !
TERRITOIRE | Les cuisiniers retracent le parcours des produits bio et locaux en Haute-Loire
ZOOM | le nouvel annuaire des fournisseurs bio est sorti !
 SOMMAIRE
SOMMAIREFOCUS | 50% de produits durables dont 20% de bio en restauration collective : les décrets publiés!
DOSSIER |Comment s’approvisionner en produits de la pêche durable en restauration collective ?
INITIATIVE | Les cuisines centrales de la région se rencontrent pour mettre du bio local dans leurs assiettes!
TERRITOIRE| les professionnels de la restauration collective se rencontrent en Haute-Loire
ZOOM | La restauration collective s’engage dans la campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal !»